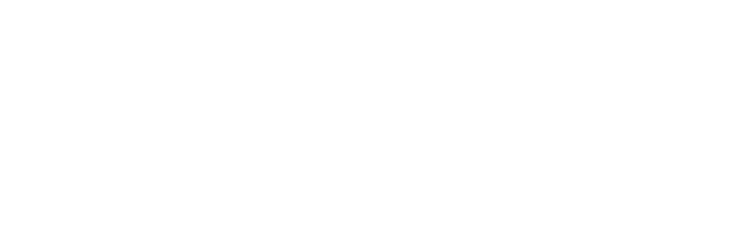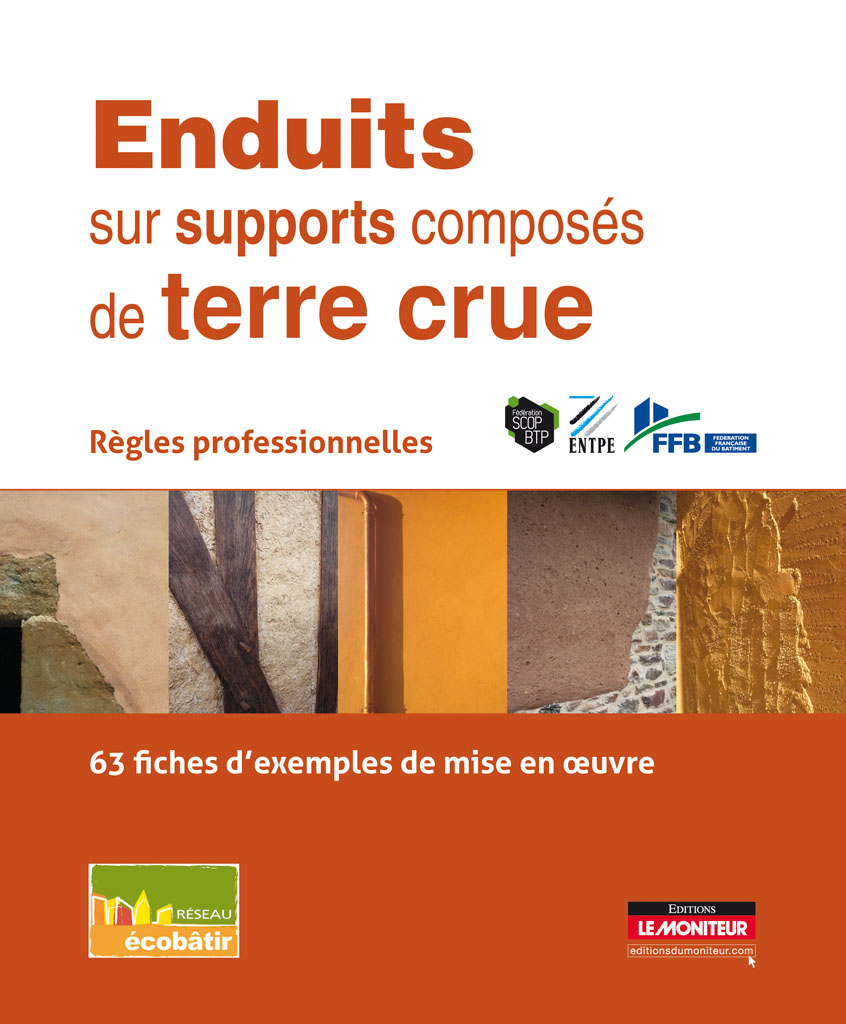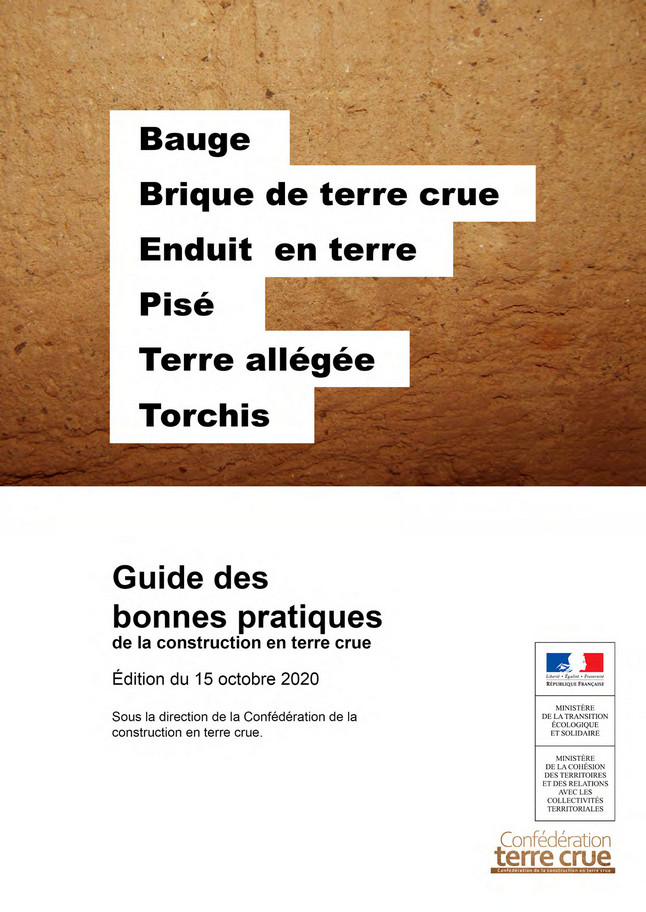Textes Normatifs
Quelques rappels : qu’est-ce qu’un texte normatif ?
Une norme est une règle fixant les conditions de la réalisation d’une opération, de l’exécution d’un objet ou de l’élaboration d’un produit dont on veut unifier l’emploi ou assurer l’interchangeabilité.
L’association française de normalisation (AFNOR) joue un rôle central et délègue à des bureaux de normalisation sectoriels (BNS) l’élaboration de projets confiés à des commissions de normalisation. Les travaux de normalisation internationale sont menés par l’Organisation internationale de normalisation, conventionnellement appelée ISO, qui publie des normes internationales destinées à harmoniser entre elles les normes nationales. Il existe aussi un Comité européen de normalisation.
Un texte normatif « donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats ». Il n’a donc pas la même portée qu’une norme, ni la même approbation, mais il peut devenir « norme ».
Un texte réglementaire est un texte législatif qui fait donc l’objet d’une application obligatoire dans les domaines visés, contrairement aux normes et aux textes normatifs.
Une approche normative fondée sur une obligation de résultat
Du fait de la variabilité des terres selon le lieu d’extraction, de la diversité des techniques et des ouvrages possibles, construire en terre crue impose des contraintes spécifiques de conception et de mise en œuvre pour adapter le projet aux ressources du site. En effet, ces pratiques constructives reposent sur des savoirs et savoir-faire spécifiques différents de ceux habituellement requis pour concevoir et construire avec des matériaux standardisés et industrialisés. Édicter des règles uniques valables pour tous et partout ne peut donc être la méthode correcte.
C’est pourquoi la Confédération de la construction en terre crue défend une approche normative basée sur une obligation de résultat. Contrairement à l’obligation de moyen, qui engage l’entreprise de construction à mettre en œuvre des moyens prescrits par un document de référence pour produire un ouvrage donné, l’obligation de résultat la contraint à livrer un résultat sans imposer les moyens pour y parvenir, ce qui implique un haut niveau de qualification des entreprises de construction.
Historique
2006 – 2012 : Les règles professionnelles « Enduits sur supports composés de terre crue »
Lors de la révision en février 2006 du NF DTU 26.1 « Travaux de bâtiment – Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne » dont le domaine d’application précise qu’il ne s’applique pas aux supports anciens notamment la terre crue – certains fabricants ont souhaité y intégrer les supports terre crue. La question posée revenait à se demander si la qualité d’un enduit sur un support de type terre pouvait être assurée par un produit, ou si elle dépendait plutôt des savoir-faire dans l’appréhension et la définition du support.
Les professionnel.les du RÉSEAU Écobâtir et de la FFB ont réagi en mettant en évidence que les enduits sur supports en terre crue (Torchis, Terre-paille, Bauge, Pisé, Pierres maçonnées à la terre, Blocs de terre compressée, Adobe), nécessitaient un texte spécifique, tant au regard de la diversité des supports, que par rapport aux enjeux relatifs à la préservation du patrimoine. C’est cette implication des professionnel.les de la terre crue dans la rédaction du DTU 26.1 en février 2006, puis l’élaboration de textes normatifs, qui ont permis au RÉSEAU Écobâtir et à la FFB de présenter, en juillet 2011, les Règles Professionnelles à la C2P, une des composantes de l’AQC. Celles-ci ont été acceptées en Juillet 2012.
Ces règles sont fondées sur des réunions entre des maçon-ne-s qui réalisent depuis plusieurs décennies des enduits sur murs de terre dans les quatre grandes régions françaises de la construction en terre crue (Bretagne, Sud-Ouest, Nord-Est, Rhône-Alpes). Lors de ces rencontres, une grande partie des connaissances, dont la culture est basée sur un savoir transmis oralement, a pu être recueillie. En complément, les retours d’expérience sur des pratiques relevées dans des documents, des centres de formation, des colloques, ou dans des échanges avec des professionnel-le-s d’autres pays, ont permis de valider les pratiques actuelles. L’ENTPE, par le savoir-faire scientifique et méthodologique de son laboratoire des géo-matériaux à Vaulx-en-Velin, a consolidé théoriquement les tests de terrain contenus dans ce document, et ce grâce à une publication scientifique validée internationalement.
2014 – 2018 : Le Guide des bonnes pratiques
Au début des années 2010, la Direction Habitat Urbanisme Paysage (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) a eu la volonté d’aider le développement des matériaux biosourcés et géosourcés, et de rédiger des guides de bonnes pratiques (GBP) pour les techniques de construction en terre crue, tant en construction neuve qu’en réhabilitation.
Afin que ces guides soient écrits par des acteur.rices de terrain, chaque association régionale a été chargée de rédiger un guide sur la technique la plus pratiquée dans sa région sur la base des retours des praticien.nes et lors de réunions régulières. Ce processus collectif de rédaction a permis d’aboutir en décembre 2018 a des textes consensuels qui constitue à ce jour les documents normatifs de référence pour l’ensemble des professionnel.les concernés directement ou indirectement par le bâtiment.
L’objectif majeur du Guide est de contribuer à créer des rapports de confiance entre les praticiens – concepteurs, bâtisseurs, ingénieurs, etc. -, et les maîtres d’ouvrages, bureaux de contrôle, assureurs et autres professionnels qui sont parties prenantes dans des ouvrages en terre crue. Les guides peuvent les aider à juger de la qualité des réalisations. Le succès des ouvrages en terre crue tient en effet à la co-réalisation des projets sur la base d’un partenariat établi le plus en amont possible entre leurs différents acteurs.
Dans les cas où les éléments fournis par les constructeurs ne suffisent pas à résoudre des problèmes de conception et de dimensionnement, les guides ont été conçus pour ouvrir la discussion afin d’aider à l’aboutissement des projets. Ces guides ne sont cependant pas des manuels pédagogiques et ne se substituent ni à une formation, ni à un apprentissage, et la pratique de la matière reste le seul moyen d’acquérir des compétences réelles.
Extrait de l’avant-propos du Guide.
Depuis 2021, un groupe de travail en interface avec le Projet National Terre
A l’issue de l’approbation collégiale du Guide des bonnes pratiques en 2018, les associations ayant participé à sa rédaction ont formalisé la Confédération de la construction en terre crue. Un groupe de travail a perduré au sein de la Confédération afin de poursuivre le travail amorcé autour des textes normatifs avec la rédaction du Guide.
Avec la mise en place du Projet National Terre en 2021, ce groupe s’est élargi aux structures membres du PN Terre afin d’être le plus représentatif possible des acteur.ices de la construction en terre crue et de veiller à ce que les recherches scientifiques répondent aux besoins de terrain en vue d’une révision du Guide des bonnes pratiques.
Sous la tutelle du conseil d’administration de la Confédération terre crue, ce groupe se donne notamment pour objectifs de :
- Rassembler des retours d’expérience ;
- Constituer une synthèse des connaissances à ce jour sur la construction en terre crue ;
- Assurer un rôle transversal avec le Projet National Terre.
- Assurer une veille concernant les documents normatifs en lien avec les techniques de construction en terre crue ;
- Représenter la filière au sein des instances normatives ;